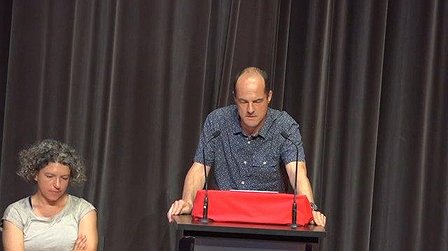Afrique : face aux rivalités impérialistes, pour une politique de la classe ouvrière
Au sommaire de cet exposé
Sommaire
- Le premier partage de l’Afrique
- Fin de la colonisation, continuité de la domination impérialiste
- La Deuxième Guerre mondiale, accélérateur de la révolte anticoloniale
- Après les indépendances, une concurrence plus ouverte
- Les éléphants blancs du Congo
- L’Afrique soumise à la financiarisation de l’économie capitaliste
- L’impérialisme français s’accroche à son pré carré
- Des rivalités responsables du génocide au Rwanda et des guerres sans fin du Congo
- Quel gendarme pour la région des Grands Lacs ?
- En Afrique de l’Est, nouvelle ruée vers l’or noir
- Mettre la main sur les gisements, pour en priver leurs concurrents
- Le prétendu développement de l’Afrique
- La déliquescence des États, produit du pillage et des rivalités impérialistes
- Le chaos se propage jusqu’au Sahel
- Des États déliquescents, tenus à bout de bras par l’impérialisme
- Le djihadisme : des bandes armées qui prospèrent sur la misère et l’absence d’État
- Le règne des mercenaires : Wagner et le mythe de l’influence russe
- La Chine domine-t-elle réellement l’Afrique ?
- La domination américaine s’amplifie : Africom et le militarisme
- Le prolétariat, force sociale de l’avenir
- La transformation sociale accélérée par les guerres
- Une seule classe ouvrière
- Les travailleurs ne sont pas des victimes, ils se battent !
- Il faut renverser le capitalisme
- L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
- Une classe ouvrière internationale
- La nécessité d’un parti ouvrier communiste en Afrique… et partout !
L’Afrique, qui représente 20 % des terres émergées – la surface réunie de la Chine, des États-Unis, de l’Europe, de l’Inde et du Japon – est un immense continent riche de colossales ressources naturelles. Mais l’écrasante majorité de ses 1,3 milliard d’habitants ne survivent qu’avec quelques dollars par jour et plus de la moitié connaissent la faim. Derrière ces statistiques froides, il y a les réalités humaines révoltantes.
À l’autre pôle, quelques dizaines de milliers de millionnaires vivent dans des îlots fermés et protégés par des gardes armés, font des allers-retours vers les grandes villes européennes et américaines.
L’Afrique est un concentré des tares et des contradictions du capitalisme, qui accumule des profits inouïs, mais est viscéralement incapable de les investir pour assurer un développement harmonieux de la société. La production électrique de toute l’Afrique subsaharienne est équivalente à celle de l’Espagne. Il y a bien des grands projets, comme en ce moment les multiples installations de la Coupe d’Afrique des nations à Abidjan, mais ils servent à pomper les richesses de l’Afrique ou à satisfaire le parasitisme des classes riches. Ce sont des poches de développement dans un océan de misère.
En 2007, Sarkozy avait déclaré plein de mépris : « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez rentré dans l’histoire. » Tout au contraire, l’Afrique est pleinement intégrée au capitalisme, depuis des siècles, avant même la colonisation. Son sort est celui réservé aux pays intégrés dans l’économie mondiale en position subalterne. Ce système n’a rien d’autre à lui offrir que ce développement inégal, qui l’a transformée en fournisseur de matières premières et a entravé son développement industriel.
Cette faillite sans appel, les défenseurs du capitalisme veulent la cacher en renvoyant sans cesse aux Africains la responsabilité de leurs propres malheurs. Ainsi Macron, représentant d’un impérialisme bâti sur le sang africain, a-t-il déclaré en mars 2023 en République démocratique du Congo : « Vous n’avez pas été capables de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire. Il ne faut pas chercher des coupables à l’extérieur. »
Cette morgue paternaliste ne doit pas nous surprendre. Comme ses prédécesseurs, Macron défend bec et ongles la présence des troupes françaises dans ses ex-colonies, et manœuvre pour garder la main sur des ressources naturelles indispensables à ses industriels. C’est là l’origine de la colère profonde et mille fois légitime contre la présence française en Afrique.
Depuis le 19e siècle, l’Afrique a été un terrain d’affrontements pour les grandes puissances. Aujourd’hui, avec l’exacerbation de la crise, l’intensification de la concurrence économique en passe de se transformer en affrontement militaire, et la mise en place d’un nouveau système d’alliances, l’Afrique est confrontée à un nouveau partage impérialiste avec, comme partout dans le monde, les États-Unis à la manœuvre en position de force.
Mais au fil des années, malgré l’immense gâchis humain, matériel et social, malgré la barbarie toujours plus grande provoquée par ces rivalités, le développement du capitalisme, si inégal et contradictoire soit-il, a aussi fait surgir en Afrique des concentrations urbaines géantes et un prolétariat qui représente la force porteuse de l’avenir.
Nous ne pourrons pas parler de tous les pays d’Afrique. Mais l’histoire de chacun démontre qu’il n’y a pas de voie pour sortir du sous-développement sans renverser l’ordre impérialiste à l’échelle de la planète.
Le premier partage de l’Afrique
En 1885 se tint à Berlin une conférence internationale sur les conditions du partage colonial de l’Afrique. Depuis le 15e siècle, les bourgeois européens y avaient établi des comptoirs et déporté des millions d’Africains, réduits en esclavage en Amérique. Ce fut une saignée, qui déstructura profondément les sociétés africaines et qui nourrit l’accumulation des capitaux européens. Puis, vers 1880, le développement prodigieux du capitalisme en Europe conduisit à la concentration des capitaux dans de grands groupes industriels et bancaires. Leur marché national ne suffisait plus. À la recherche de débouchés pour investir leurs capitaux pléthoriques et sécuriser leurs sources de matières premières, ils se jetèrent à l’assaut du monde entier.
Le capitalisme entrait dans l’époque impérialiste, celle des conquêtes, des guerres et du pillage généralisés. Au moment de la conférence de Berlin, la Grande-Bretagne avait pris pied au Cap en Afrique du Sud, en Sierra Leone, dans le futur Ghana et à Lagos, le principal port du Nigeria. La France renforçait ses positions au Sénégal. L’Allemagne, elle, avait pris du retard.
La conférence fixa la règle pour le partage de l’Afrique : premier arrivé, premier servi ! Aucun représentant africain n’y fut évidemment invité. Les puissances qui pesaient étaient la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne. Les États-Unis, encore puissance de second plan, étaient présents. Ils n’avaient pas de possession en Afrique et avaient encore à développer leur immense territoire intérieur. Pour autant, les États-Unis ne voulaient pas laisser la place aux seules puissances européennes.
Si toutes les puissances lorgnaient sur le Congo, cette région aussi vaste que l’Europe de l’Ouest, aucune n’était en situation de s’y imposer. Elles préférèrent le céder à Léopold II, le roi des Belges, plutôt qu’une de leurs rivales ne s’en saisisse. Et c’est ainsi que la petite Belgique mit la main sur l’immense Congo. Lénine résuma dans son livre, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, l’esprit des puissances concurrentes : « L’essence même de l’impérialisme, c’est la rivalité de plusieurs grandes puissances tendant à l’hégémonie, c’est-à-dire à la conquête de territoires, non pas tant pour elles-mêmes que pour affaiblir l’adversaire et saper son hégémonie. »
Pour justifier l’invasion coloniale, la conférence de Berlin prétendit défendre la « liberté de commerce », la « tolérance religieuse » et même la « lutte contre la traite des esclaves ». Déjà, derrière les envolées morales très lyriques, il s’agissait de dépecer le continent, ce qu’exprima avec cynisme le Premier ministre britannique : « Nous avons entrepris de tracer des lignes sur les cartes de régions où l’homme blanc n’avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribué des montagnes, des rivières, des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions pas exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières et ces lacs. »
L’intérieur de l’immense continent africain était quasi inconnu… pour les Européens du moins ! Car l’Afrique avait une histoire extrêmement riche. La conquête coloniale se heurta à la résistance des populations et de certains dirigeants africains. Mais elle fut écrasée par la supériorité technologique des Européens. Un politicien anglais résuma le rapport de force : « Quoi qu’il arrive, nous avons le fusil Maxim, les autres non. »
En quinze ans, tout le continent fut partagé, des frontières furent tracées à la règle. Les puissances coloniales s’attelèrent au pillage des ressources nécessaires à leur industrie, l’huile de palme, le coton, le caoutchouc. Le travail forcé devint la règle, dépeuplant les villages obligés de fournir des bras pour les plantations des Européens, la construction des routes et des voies ferrées. Les rares investissements furent pour les routes, ports et chemins de fer nécessaires aux exportations. Ce pillage de l’Afrique la plaçait d’emblée en position subalterne dans l’économie mondiale, comme productrice de matières premières, sans aucun développement industriel.
L’Afrique dans la Première Guerre mondiale
En 1898, le premier partage de l’Afrique se termina à Fachoda, au sud du Soudan, où les troupes britanniques et françaises furent à deux doigts de se battre. En 1911, au Maroc, ce furent cette fois la France et l’Allemagne qui manquèrent d’engager les hostilités. L’Afrique partagée, comme le monde entier, les rivalités s’exacerbaient et ne pouvaient que déboucher sur un affrontement plus large : il éclata en 1914.
Durant la Première Guerre mondiale, l’intégration de l’Afrique à l’économie mondiale s’accéléra. Le Nigeria fournit de l’étain, le Congo du cuivre. Les colonies alimentaient les métropoles et leurs armées en nourriture, ce qui déclencha des famines. Et le continent africain servit de réservoir de chair à canon. 200 000 tirailleurs furent embrigadés dans l’armée française. Les réquisitions provoquèrent des révoltes dans bien des régions. Car la guerre, si elle plongeait le monde capitaliste dans la barbarie, préparait aussi la révolution. Le bouleversement de la vie de centaines de millions de personnes, les souffrances et les morts, catalysaient la prise de conscience des opprimés.
La vague révolutionnaire et la fondation de l’Internationale communiste
Partie de Russie en 1917, la vague révolutionnaire submergea le monde entier pendant plusieurs années. Sur la question coloniale, l’Internationale communiste, fondée par les bolcheviks en 1919, affirma : « Tout parti appartenant à la IIIe Internationale a pour devoir […] de soutenir, non en paroles, mais en fait, tout mouvement d’émancipation dans les colonies, d’exiger l’expulsion des colonies des impérialistes de la métropole. »[1]
Ce programme n’était pas un programme humaniste ou démocrate. C’était un programme internationaliste, pour unir tous les opprimés dans un combat commun pour renverser le capitalisme. Les impérialistes s’appuyaient sur le pillage des ressources des colonies et l’exploitation de leurs millions de travailleurs. En expulsant les puissances coloniales, les masses pauvres des pays colonisés se seraient émancipées de leurs exploiteurs les plus puissants, et auraient affaibli les impérialistes européens, joignant leurs forces au combat des travailleurs des métropoles. En 1919, en pleine vague révolutionnaire mondiale, ce combat n’était pas une vue de l’esprit.
La guerre avait entraîné dans la même barbarie les exploités d’Afrique et d’Europe. Sur les champs de bataille, les Africains enrôlés dans les troupes coloniales avaient appris à se battre, comme le montre le film Tirailleurs. Des travailleurs venus du Maghreb et d’Indochine découvraient les bagnes industriels en France. Tous partageaient les souffrances de la guerre et de l’exploitation. Dans les casernes, les tranchées et les usines, ils côtoyaient des militants et s’engagèrent. Le sénégalais Lamine Senghor, ancien tirailleur devenu facteur à Paris, milita dans l’Union inter-coloniale créée par le jeune Parti communiste. Il écrivait dans son journal Le Paria. En 1925, Lamine Senghor prit place à la tribune d’un meeting rassemblant 60 000 travailleurs à Paris contre la répression par l’armée française de la révolte anticoloniale dans le Rif marocain.
Les partis de l’Internationale communiste soutenaient tous les peuples opprimés qui se soulevaient contre l’impérialisme, même quand ils combattaient sous la direction de forces bourgeoises ou petites-bourgeoises. Mais l’Internationale défendait avant tout la nécessité que les travailleurs, même quand ils étaient très peu nombreux, s’organisent dans des partis communistes indépendants de tous les courants nationalistes ou réformistes.
Défendre l’indépendance politique de la classe ouvrière, même embryonnaire
Dans les colonies, où la classe ouvrière n’était qu’embryonnaire, ces recommandations de l’Internationale étaient une anticipation du fait que l’expansion du capitalisme allait faire surgir partout une classe ouvrière. Cela avait déjà été le raisonnement et le choix politique des premiers militants marxistes russes, à la fin du 19e siècle, alors que la classe ouvrière était toute jeune et minoritaire en Russie. Ce choix montra toute sa justesse en octobre 1917, quand les ouvriers et le Parti bolchevique prirent le pouvoir, avec l’appui de la paysannerie pauvre. Dans de vastes régions d’Asie, sans industrie ni classe ouvrière, les peuples auparavant soumis au régime tsariste s’émancipèrent en liant leur sort au pouvoir ouvrier. C’est toute cette expérience qui guidait l’Internationale communiste.
En Afrique, la production pour l’économie de guerre avait fait apparaître les premiers prolétaires, notamment dans la marine et les chemins de fer nécessaires aux exportations. Les travailleurs commencèrent à s’organiser. Au Sénégal, le premier syndicat de marins fut créé par des militants liés à la CGT, comme Maguette Ndiaye, qui avait été soldat et marin pendant la guerre.
En 1919, sur la ligne de chemin de fer de Dakar, les cheminots africains firent grève pour la première fois, pour l’indexation des salaires rongés par l’inflation, et entraînèrent leurs camarades de travail européens. À peine née, la classe ouvrière africaine engageait à son tour le combat contre l’exploitation.
Les États-Unis, vainqueurs mais prudents sur les colonies
La guerre mondiale modifia les rapports de force entre impérialistes et consacra la domination américaine. Dès 1900, la conquête de l’Ouest achevée, les États-Unis avaient étendu leur influence en Amérique latine, dans la Caraïbe et le Pacifique. Ils soumettaient par leur puissance économique des États plus faibles, et quand ceux-ci résistaient, les navires de guerre américains et leurs marines intervenaient bien sûr au nom de la « liberté du commerce » et de la « démocratie »… en réalité pour leurs intérêts capitalistes.
Le président américain Theodore Roosevelt résuma cette méthode ainsi : « J’ai toujours aimé ce proverbe d’Afrique de l’Ouest : “Parle doucement, porte un gros bâton, et tu iras loin”. »
Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis se présentèrent comme les champions du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, formule que reprenait le président Wilson dans son programme pour l’après-guerre. Wilson prétendait résoudre la question coloniale par un « arrangement libre ». Cette posture anticoloniale des États-Unis, permise par leur puissance économique, deviendra un élément récurrent de leur politique internationale.
Mais en même temps, les États-Unis ne voulaient surtout pas d’une décolonisation arrachée par les peuples. Ils laissèrent les Britanniques et les Français jouer le rôle de gendarmes dans leurs empires coloniaux, et mettre la main sur les colonies allemandes d’Afrique. Le Togo et le Cameroun devinrent ainsi des territoires sous mandat français et britannique, en réalité des colonies, avec la caution de la Société des nations, l’ancêtre de l’ONU, que Lénine qualifia de « caverne de brigands » !
La France et la Grande-Bretagne, devenues des impérialismes de second rang, s’accrochaient d’autant plus à leurs monopoles coloniaux que ceux-ci leur assuraient un rôle international dépassant de loin leur réelle puissance économique. Le pillage colonial fit la fortune de dynasties bourgeoises qui ont prospéré jusqu’à nos jours, comme l’empire du coton Boussac, racheté en 1984 pour une bouchée de pain par un certain Bernard Arnault !
Fin de la colonisation, continuité de la domination impérialiste
Durant la Deuxième Guerre mondiale, l’Afrique servit à nouveau de base arrière aux grandes puissances. Le Congo, repris par les Alliés alors que la Belgique était occupée par l’armée allemande, fournit l’uranium de la bombe atomique qui anéantit Hiroshima. Une nouvelle fois, des centaines de milliers d’hommes furent enrôlés dans les troupes coloniales. Parmi eux, l’espoir de voir les choses changer après la guerre devint immense. Gaston Donnat, un cadre du PCF qui militait alors au Cameroun, explique ainsi : « Le déroulement de la guerre était suivi dans les quartiers africains. Les boys transmettaient les nouvelles qu’ils entendaient chez leurs patrons. Il y avait aussi les lettres qu’écrivaient ou que faisaient écrire les soldats au combat. »[2]
La Deuxième Guerre mondiale, accélérateur de la révolte anticoloniale
L’autorité des puissances coloniales, comme la France battue en 1940, était minée. Au sortir de la guerre, les révoltes éclatèrent. Les travailleurs y jouèrent un rôle actif, comme en 1947, lors de la grève des cheminots du Dakar-Niger. Le roman Les bouts de bois de Dieu montre la force de cette grève, que son auteur, Ousmane Sembene, décrit comme « un moment clé dans la grande mobilisation anticolonialiste ».
D’un bout à l’autre du continent, la révolte se propageait. La réponse des autorités coloniales fut partout la même. En décembre 1944, au camp de Thiaroye au Sénégal, l’armée française tua plus de 190 tirailleurs qui réclamaient leur prime de démobilisation. En septembre 1945 à Douala, au Cameroun, des milices coloniales tuèrent des centaines de travailleurs en lutte contre la hausse du prix des aliments et entraînés par les cheminots en grève. En 1947, à Madagascar, 89 000 paysans insurgés contre les travaux forcés et les pénuries alimentaires étaient tués par l’armée française. Autant de massacres largement occultés par les livres d’histoire !
Les États-Unis laissèrent les puissances européennes rétablir l’ordre dans les colonies. Ils ne voulaient surtout pas que les révoltes se développent vers une contestation plus large du système capitaliste, comme après la Première Guerre mondiale. Pour la même raison, Staline aussi appuya les puissances coloniales. Les partis communistes européens, profondément dénaturés par le stalinisme, engagèrent leur crédit et leur influence pour aider leur bourgeoisie à rétablir sa domination, dans les métropoles comme dans les colonies.
Ainsi, au moment de la conférence de Brazzaville en 1944, lors de laquelle de Gaulle réaffirma que le lien entre la France et ses colonies était « définitif », le PCF déclara : « Pour la France, être une grande puissance européenne et mondiale et tout simplement continuer d’exister est la même chose. Unité et intégrité de la plus grande France, des Antilles à Madagascar, de Dakar à Casablanca, de l’Indochine à l’Océanie. »[3]
Ce langage était l’opposé exact de celui que tenait l’Internationale communiste vingt-cinq ans plus tôt, à l’époque de Lénine. La dégénérescence stalinienne avait fait des partis communistes des défenseurs de l’ordre impérialiste. Cette évolution, démarrée dès le milieu des années 1920, avait empêché l’émergence de partis communistes révolutionnaires en Afrique, qui manquèrent aux exploités des colonies au moment où la révolte gonflait partout.
Des révoltes anticoloniales dirigées par des nationalistes
Dans cette effervescence sociale, des partis africains furent néanmoins créés, souvent en lien avec les partis de gauche des métropoles. En Afrique francophone, le PCF et la CGT formèrent bien des dirigeants, comme Ruben Um Nyobe au Cameroun, ou Sékou Touré, dirigeant du premier syndicat des postiers de Guinée. Ce ne fut pas sur la base du marxisme, que les staliniens avaient abandonné, mais sur une base nationaliste et réformiste. Le PCF prétendait ainsi que dans les colonies il était « dangereux de faire jouer à la classe ouvrière le rôle dirigeant dans le mouvement politique. »[4]
À cette école, les dirigeants indépendantistes africains apprirent à se méfier des masses, tout en s’appuyant sur leur révolte et en l’utilisant pour leurs objectifs politiques. Ils gagnèrent du crédit, en exprimant la haine légitime des peuples contre l’oppression impérialiste, comme le guinéen Sékou Touré, qui osa dire « non » à de Gaulle, s’opposant au projet d’Union française destinée à préserver le pré carré de la France.
Ces leaders nationalistes voulaient arracher un espace vital pour leur pays au sein de l’ordre impérialiste, sans remettre en cause ni le capitalisme, ni la domination impérialiste, ni même souvent les frontières tracées à Berlin ou à Versailles des décennies plus tôt. Malgré cela l’espoir d’émancipation qu’ils représentaient aux yeux des masses en fit des hommes à abattre pour l’impérialisme.
Pour les États-Unis, la décolonisation signifiait l’ouverture des monopoles coloniaux à leurs capitalistes. En 1957, après une tournée dans les pays africains devenus indépendants, Richard Nixon, alors vice-président, écrivit : « L’émergence d’une Afrique libre et indépendante est aussi importante pour nous sur le long terme qu’elle l’est pour les peuples de ce continent. » Les mots « sur le long terme » étaient importants. C’était la guerre froide et les États-Unis craignaient toute révolte et ne voulaient de changement que sous contrôle de l’impérialisme. C’est ainsi qu’ils fournissaient au même moment du matériel militaire à l’armée française qui massacrait en Algérie
Les indépendances contrôlées des anciennes colonies françaises
La France avait réprimé systématiquement les nombreuses révoltes qui suivirent la guerre. Mais elle avait dû décamper d’Indochine. Face aux pressions américaines et aux révoltes anticoloniales, elle dut se résoudre à accepter l’indépendance formelle de ses colonies, tout en manœuvrant pour que rien ne change sur le fond. C’est pour mener cette politique au mieux des intérêts de la bourgeoisie française que de Gaulle arriva au pouvoir en 1958, en pleine guerre d’Algérie.
De Gaulle sélectionna des dirigeants dévoués, comme le premier président du Sénégal, Léopold Senghor, ou Félix Houphouët-Boigny, qui dirigea la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993. Houphouët était médecin et riche propriétaire d’une exploitation de cacao. Élu député en 1945, il fut un temps proche du PCF, avant de se rapprocher de Mitterrand et de participer de 1956 à 1961 aux gouvernements français qui réprimaient en Algérie et au Cameroun.
Au Cameroun, l’armée française lança ses troupes contre l’Union des populations du Cameroun. Elle assassina plus de 100 000 personnes, au nom de la « défense de la civilisation et du monde libre ». Elle brûla les villages au napalm et déporta leurs habitants dans des camps, comme l’a dénoncé Mongo Beti dans ses livres, qui furent censurés en France. En septembre 1958, les militaires français exécutèrent Ruben Um Nyobe.
Pendant cette sale guerre coloniale, de Gaulle sélectionna un serviteur fidèle, Amadou Ahidjo. Dans son sillage se trouvait Paul Biya, toujours à la tête du Cameroun depuis 1982.
Pour assurer sa domination sur ses anciennes colonies devenues indépendantes, le petit impérialisme français ne pouvait pas compter sur la puissance de son industrie ou de sa monnaie, contrairement aux États-Unis. Il devait maintenir son hégémonie par des instruments administratifs. La France créa le franc CFA, hérité de la monnaie coloniale, dont le cours est encore aujourd’hui décidé à Paris. Et ses « conseillers » tenaient étroitement en main les administrations, les armées et les politiciens placés à la tête des États dits indépendants, pour défendre les intérêts de sa bourgeoisie.
L’impasse du nationalisme
Après 1960, dans les pays dirigés par des nationalistes qui n’étaient pas des affidés de l’ancienne puissance coloniale, en Guinée, au Mali, au Ghana, l’enthousiasme des indépendances fut rapidement douché par les difficultés économiques et sociales. Pour encadrer la population et imposer des efforts sous prétexte du développement national, ces régimes devinrent de plus en plus autoritaires.
Les rêves panafricains de leurs dirigeants se heurtèrent aux ex-puissances coloniales, qui utilisaient les frontières pour diviser et régner. L’impérialisme français fit ainsi avorter un projet d’union entre le Mali, le Sénégal et les actuels Burkina Faso et Bénin, soutenant les intrigues de Houphouët. Celui-ci s’opposa à toute tentative de fédération, qui aurait fait selon lui de la Côte d’Ivoire « la vache à lait de l’Afrique de l’Ouest ».
Mais l’unification du continent échoua aussi du fait des choix des dirigeants nationalistes. Les couches sociales dont ces dirigeants défendaient les intérêts, la petite bourgeoisie intellectuelle, les commerçants aisés, les bourgeois ruraux, souhaitaient garder leur propre appareil d’État et les moyens qu’il leur offrait pour s’enrichir. Ils refusaient de se soumettre à un pouvoir étatique plus large sur lequel ils n’auraient pas de prise. Ils étaient incapables d’unifier le continent, comme les bourgeois européens sont incapables d’unifier réellement même la petite Europe.
Cette unification du continent aurait représenté un immense pas en avant et ouvert des perspectives bien différentes aux peuples d’Afrique pour échapper à la domination impérialiste. La puissance du soulèvement anticolonial aurait pu la réaliser. Les tirailleurs de l’armée française avaient vécu dans leur chair un sort commun, qu’ils viennent du Sénégal, du Congo, de Mauritanie, de Guinée ou du Mali. Les travailleurs auraient pu mener ce combat, car eux n’avaient aucun intérêt au maintien des États nationaux.
Un pouvoir des travailleurs et des paysans pauvres, même dans un seul pays, aurait eu des répercussions immenses dans toute l’Afrique et au-delà. Il aurait mené une politique pour s’adresser aux travailleurs des autres pays, pour étendre la révolution et remettre en cause les frontières et les États nationaux. Mais il n’y eut aucun parti pour défendre cette politique. Même quand il y eut un début de mobilisation des masses, les dirigeants nationalistes en gardèrent le contrôle. Pour tenter d’exister, ces dirigeants jouèrent alors des rivalités entre les anciennes métropoles coloniales, les États-Unis et l’Union soviétique. Des milliers de jeunes Guinéens et Angolais partirent étudier en URSS. Parfois, quand les grandes puissances mettaient sur la touche un dirigeant africain trop indocile, cette coopération avec l’URSS devenait militaire. Mais ces relations, liées à l’attitude des impérialistes, étaient instables. Des dirigeants s’affirmant marxistes un jour pour obtenir le soutien soviétique, se tournaient le lendemain vers les États-Unis ou la France.
L’impérialisme garda la main, et continua à écarter ou assassiner ceux qui, ne serait-ce que par leurs discours anti-impérialistes, avaient une certaine popularité. Ainsi en 1987, au Burkina Faso, Thomas Sankara fut assassiné par son bras droit Blaise Compaoré, qui devint l’homme de main de la France.
Au fond, les dirigeants nationalistes, même les plus déterminés, avaient une marge de manœuvre extrêmement limitée. Appuyés sur une mince couche de notables et de militaires, ils n’avaient pas les moyens de transformer profondément la société. En ne remettant pas en cause les frontières héritées de la colonisation, en défendant des États nationaux appuyés sur des économies tournées uniquement vers la production de matières premières, ils ne pouvaient développer leur pays. Hier comme aujourd’hui, il n’y a de voie de développement, en Afrique comme ailleurs, qu’en socialisant les moyens de production et de distribution, à l’échelle de la planète.
Le Congo indépendant déchiré par les rivalités impérialistes
Parmi toutes les ex-colonies, le Congo et ses immenses ressources minérales furent l’objet d’une intense rivalité. En 1955, les États-Unis avaient déjà signé avec la Belgique un accord qui leur réservait une large partie de l’uranium du Katanga, la riche région minière au sud du pays, où la puissance coloniale belge exploitait le cuivre, le cobalt et l’étain.
Contrairement à ce que la France avait engagé après les révoltes anticoloniales au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique n’avait préparé aucun personnel politique pour lui servir de relais dans le mouvement de décolonisation. Patrice Lumumba incarna la voie nationaliste, voulant « obtenir, dans un délai raisonnable et par voie de négociations pacifiques, l’indépendance du pays ». Mais en janvier 1959, une immense révolte urbaine à Kinshasa accéléra brutalement le cours des événements, et les dirigeants belges durent céder l’indépendance en juin 1960.
Une lutte pour le pouvoir s’engagea. Lumumba, devenu Premier ministre, défendait l’unité du pays mais n’avait pas de base dans la plupart des régions de ce vaste territoire. Confronté à une sécession du Katanga encouragée par les Belges et les Français, Lumumba en appela en vain à l’ONU, avant d’être écarté du pouvoir par ses rivaux. Son bras droit, Mobutu Sese Seko, soutenu par la CIA, s’empara du pouvoir par un coup d’État. Lumumba fut déporté et assassiné au Katanga, sur ordre des Belges, des Français et des Américains, avec la caution de l’ONU. Pour avoir été un leader indépendantiste déterminé, et l’avoir payé de sa vie, Lumumba devint un symbole de la lutte contre l’impérialisme bien au-delà du Congo.
Mais pour les États-Unis, la désagrégation du Congo risquait d’ouvrir la voie à l’influence soviétique, et à leurs rivaux belges et français. Ils intervinrent donc militairement, via l’ONU, pour mettre fin à la sécession katangaise.
En 1965, Mobutu imposa sa dictature. Il devint pour trente ans l’homme de main des États-Unis, utilisant aussi les services des barbouzes français, tout en jouant des sentiments anti-impérialistes de la population. Toujours coiffé de sa toque en peau de léopard, il nationalisa les mines et prétendit incarner une voie de développement spécifique pour les pays africains.
Après les indépendances, une concurrence plus ouverte
Après les indépendances, les puissances impérialistes provoquèrent ou aggravèrent des conflits internes pour remettre en cause certaines de leurs chasses gardées. Ce fut le cas de la France et de la Grande-Bretagne pour le contrôle du Biafra, une région pétrolière du sud du Nigeria. Entre 1967 et 1970, deux millions de personnes moururent, dans une guerre pendant laquelle la France livra des armes dans de fausses opérations humanitaires, un mensonge appelé à se répéter.
Dans les années 1970, les États indépendants furent confrontés à un nouveau problème, l’éclatement de la crise économique. Elle entraîna la montée du chômage dans tous les pays, l’accumulation de profits sans débouchés dans les pays occidentaux, et en conséquence la financiarisation de l’économie, c’est-à-dire sa soumission à la spéculation financière.
L’Afrique devint un terrain de placements profitables pour les financiers occidentaux. Ils poussèrent tous les pays à s’endetter pour financer des travaux publics, le plus souvent des « éléphants blancs », comme en Côte d’Ivoire la basilique de Yamoussoukro, inspirée de Saint Pierre de Rome et voulue par Houphouët. Ces dépenses somptuaires, installations industrielles et infrastructures inutiles aux populations, rapportèrent gros aux capitalistes occidentaux ainsi qu’aux élites locales.
Les éléphants blancs du Congo
Le Congo (Kinshasa) fit construire le barrage hydroélectrique Inga par une entreprise italienne. De ce barrage, Mobutu fit édifier une titanesque ligne électrique de 1 700 kilomètres jusqu’au Katanga. Construite par une entreprise américaine, avec des pylônes US Steel et du matériel General Electric, cette ligne ne fonctionna au mieux qu’à 10 % de ses capacités !
Les capitalistes français participèrent à la curée. Thomson-CSF construisit ainsi dans tout le Congo un système de communication radio qui tomba rapidement en panne, aucune maintenance n’ayant été prévue. Tous ces projets étaient financés sans restrictions par l’aide au développement et des prêts des banques américaines, françaises et belges.
L’État congolais s’endetta massivement mais, quand les prix du cuivre et du cobalt s’effondrèrent, la dette devint impossible à rembourser. Le FMI imposa alors un plan d’austérité, reconduit à huit reprises sous Mobutu. En 1983, 400 000 fonctionnaires furent licenciés du jour au lendemain ; la majorité des centres de soins et des écoles du pays furent fermés ou privés de personnel. Ce fut une régression foudroyante. La monnaie s’effondra, mais Mobutu put continuer à acheter des villas sur la Côte d’Azur sans interdit bancaire.
L’Afrique soumise à la financiarisation de l’économie capitaliste
Contrairement aux mensonges répétés par nombre de commentateurs, cette catastrophe n’était pas due aux seules frasques de Mobutu. La même s’est produite dans presque tous les pays pauvres. Partout, l’endettement fut suivi des « plans d’ajustement structurels » du FMI et de la Banque mondiale, qui ont soutenu ces pays comme la corde soutient le pendu. Ils firent exploser la pauvreté et ruinèrent le peu de services publics, dans l’éducation et la santé. Et les grands groupes occidentaux mirent la main quasi gratuitement sur les entreprises d’État. En Afrique de l’Ouest, Bouygues récupéra les réseaux de distribution d’eau, France Telecom le téléphone et Bolloré les réseaux ferrés et les ports.
Mais si les capitalistes français, protégés dans la zone du franc CFA, se gavaient, les interventions du FMI et de la Banque mondiale reflétaient la domination croissante des États-Unis, qui jouent un rôle prépondérant dans ces organismes. Mitterrand, conscient des menaces sur le pré carré africain de la France, le formula cyniquement en 1984 en déclarant : « Le danger, c’est l’Américain, qui cherche à nous supplanter sur notre terrain d’excellence. » À la fin des années 1980, cette pression des États-Unis, dans la lutte permanente que se mènent les impérialistes, fut débridée par l’affaiblissement puis la chute de l’URSS.
Forts de leur puissance économique, les États-Unis poussèrent au multipartisme. Cette politique visait à préparer la relève des vieux régimes de parti unique, pourris jusqu’à la moelle mais servant de garde-fous contre l’influence soviétique, comme celui de Mobutu. Les plans d’austérité avaient laminé la société, et la colère était grande contre ces dirigeants. Des opposants politiques s’appuyaient dessus pour tenter de prendre la place. Le multipartisme fut donc à la fois un moyen de canaliser la contestation et de sélectionner de nouvelles équipes dirigeantes.
Dans les prés carrés des ex-puissances coloniales, c’était aussi un moyen de redistribuer les cartes et les marchés. Pour les classes populaires par contre, le multipartisme n’apportait pas le moindre droit démocratique.
L’impérialisme français s’accroche à son pré carré
Pour sauver son influence, la France poussa elle aussi ses hommes liges à accepter des partis politiques concurrents. Ce ravalement de façade assura la continuité des profits de Total, Areva ou Castel, groupe de boissons français dont la bière inonde toujours le continent depuis 1950. Mais si la vieille bourgeoisie des pays impérialistes a appris depuis des lustres à gérer des alternances électorales, cela ne va pas de soi dans des pays pauvres, où l’enrichissement dépend directement des relations avec le pouvoir politique. Des luttes féroces pour le pouvoir éclatèrent entre politiciens. Dépourvus de base sociale solide, ils s’appuyèrent sur l’ethnisme ou la religion pour s’assurer une clientèle électorale.
En Côte d’Ivoire, à la mort de Houphouët en 1993, ces rivalités politiciennes plongèrent le pays dans le chaos, introduisant la division dans les quartiers et les cours communes où vivent les travailleurs, de toutes ethnies et des pays voisins. Les riches et les politiciens qui utilisaient « l’ivoirité » et la xénophobie se moquaient bien des conséquences, à l’abri dans leurs villas.
En 2011, après une longue période de partition, de guerre et d’interventions militaires françaises, Alassane Ouattara fut finalement poussé au pouvoir. Proche de la France, ami de Martin Bouygues et du fils Mitterrand, Ouattara avait aussi travaillé au FMI, et c’est fort du soutien des institutions financières internationales qu’il a pu prendre le pouvoir et s’y maintenir jusqu’à aujourd’hui.
Dans les années 1990, en Afrique de l’Ouest, l’impérialisme français préserva son influence, au prix du chaos en Côte d’Ivoire, et du soutien à des régimes dictatoriaux. Mais au Rwanda, en Afrique centrale, sa présence était bousculée par les États-Unis, qui renforçaient notamment leur soutien militaire à l’Ouganda, un pays anglophone frontalier du Congo et du Rwanda.
Des rivalités responsables du génocide au Rwanda et des guerres sans fin du Congo
Alors que les besoins en cuivre, en cobalt et en métaux rares explosaient parallèlement au développement de l’informatique et des télécommunications, cette région était au cœur des luttes pour le contrôle des ressources naturelles, comme à la fin du 19e siècle, sauf que le coltan remplaçait le caoutchouc. Jusqu’où les requins étaient prêts à aller, cela se révéla dans toute son horreur lors du génocide au Rwanda en 1994, qui fit peut-être un million de morts.
Depuis 1973, le Rwanda, ex-colonie belge, était passé sous domination française, à travers le régime militaire de Habyarimana. Cette dictature s’appuyait sur les extrémistes hutus et son acte fondateur avait été des massacres de Tutsis, utilisés auparavant par les colonisateurs contre les Hutus, afin de « diviser pour mieux régner ». À partir de 1990, parmi les réfugiés tutsis en Ouganda, le Front patriotique rwandais contesta le pouvoir de Habyarimana. La rébellion militaire du FPR était dirigée par l’actuel président rwandais, Paul Kagamé, avec l’appui direct des États-Unis.
La France soutint jusqu’au bout le régime extrémiste hutu qui organisa le génocide. Ce n’était pas une erreur d’appréciation : tous les dirigeants français étaient d’accord, qu’ils soient de gauche comme Mitterrand et Hubert Védrine, ou de droite comme Balladur et Alain Juppé. Confronté à la victoire du FPR pro-américain, le gouvernement français organisa une fausse opération humanitaire, avec la caution de l’ONU, pour protéger les génocidaires. Ils furent exfiltrés vers le Congo voisin, mêlés à des centaines de milliers de réfugiés rwandais. Ces événements dramatiques précipitèrent tout le Congo dans la guerre.
Au Congo, depuis la fin du régime de parti unique de Mobutu en 1991, la situation politique était chaotique. Le délabrement de l’État était tel que même l’exploitation minière était en chute libre. Les États-Unis poussèrent alors au pouvoir Laurent-Désiré Kabila, un chef de guerre qui s’était taillé un fief à l’est du pays. En 1997, Kabila renversa Mobutu avec l’appui des armées ougandaise et rwandaise, qui combattaient à l’est du Congo les milices génocidaires hutues.
Les bandes armées de Kabila et de ses alliés se finançaient en vendant des gisements miniers à des groupes américains, canadiens, britanniques et sud-africains. Le canadien Banro Resources mit la main sur l’étain, l’or et le coltan de la Société Minière du Kivu ; De Beers sur ses diamants ; et l’American Mineral Fields sur le cuivre et le cobalt du Katanga.
Dans cette lutte pour le contrôle des richesses du Congo, les trusts français furent mis hors-jeu, car la France soutint jusqu’au bout Mobutu. Pendant des années, le Congo fut ensanglanté par les exactions des milices, alliées ou rivales du gouvernement, d’origine congolaise ou étrangère. Ces guerres furent les plus meurtrières depuis la Deuxième Guerre mondiale, et ont impliqué jusqu’à huit pays africains.
Malgré le chaos, l’or, le cobalt, les diamants et les métaux rares du Kivu ou du Katanga ont nourri le trafic de « minerais de sang »[5]. Ils ont assuré des profits faramineux aux géants capitalistes, Glencore, De Beers, Rio Tinto, qui ont leurs sièges dans de luxueux immeubles, en Suisse, à New York ou à Londres.
Quel gendarme pour la région des Grands Lacs ?
Aujourd’hui, l’est du Congo est toujours ravagé par les combats. Ils font partie de la guerre que se mènent les impérialistes à l’échelle mondiale. Pour la population, ce sont les massacres au quotidien. Les milices attaquent les villages et volent les récoltes de cacao, les coupeurs de routes rackettent les chauffeurs routiers et assassinent ceux qui résistent. Les mineurs extraient le coltan, l’or, les diamants, sous la menace des kalachnikovs des miliciens qui contrôlent les mines. Et bien des femmes subissent viols et mutilations sexuelles.
La chute de Mobutu a aussi laissé vacant le poste de gendarme de la région. Plusieurs pays dotés d’une armée solide et bien équipée prétendent jouer ce rôle : l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, et derrière eux leurs parrains impérialistes. L’armée rwandaise, forte de l’appui américain et du crédit politique de Kagamé, qui a mis fin au génocide de 1994, est l’une des plus solides. Économiquement, le Rwanda est une plaque tournante du trafic des minerais de sang du Congo. Ce trafic finance le régime de Kagamé, ainsi que les campagnes visant à masquer son caractère dictatorial. C’est ainsi que l’on voit le slogan « Visit Rwanda » jusque dans les stades européens et sur les maillots des joueurs du PSG et d’Arsenal.
Aujourd’hui, ni les liens du dictateur Kagamé avec les États-Unis ni la politique criminelle de la France dans le génocide des Tutsis n’empêchent les capitalistes français de revenir au Rwanda. Vivendi, le groupe de médias et de communication de Bolloré, a fait construire dans la capitale un service de fibre optique ainsi qu’un complexe de loisirs, avec cinéma, salle de concert et restaurants. Total y a signé des contrats commerciaux. Quant au Danemark et au Royaume-Uni, ils ont signé avec le Rwanda des accords pour y déporter les migrants qui arrivent sur leur sol.
En Afrique de l’Est, nouvelle ruée vers l’or noir
Dans toute l’Afrique de l’Est, la concurrence s’est encore accrue depuis la découverte d’hydrocarbures. Et même si la production est souvent hypothétique, la compétition est rude entre les compagnies françaises, américaines, italiennes, chinoises, soutenues par leurs États respectifs. En Ouganda, dans le lac Albert à la frontière avec le Congo, Total, associé en position dominante avec l’entreprise publique chinoise CNOOC, met en exploitation d’importantes réserves de pétrole.
Cynisme peut-être involontaire, les zones d’extraction ont été appelées Tilenga, le nom d’une antilope menacée par le projet, et Kingfisher, le martin-pêcheur, le roi des pêcheurs. Mais le roi, c’est Total. Et l’État ougandais doit en passer par ses conditions. Il a par exemple dû renoncer à construire une grande raffinerie car Total veut exporter le pétrole brut, et garder le contrôle du raffinage.
Pour exporter le pétrole, Total a imposé son projet EACOP (East Africa Crude Oil Pipeline), un oléoduc chauffé de 1 444 km qui débouchera dans un port de Tanzanie. Il traversera des réserves naturelles, des zones agricoles et des réserves d’eau potable d’une région où vivent 40 millions de personnes. D’ores et déjà, plus de 110 000 personnes ont été chassées de leurs maisons. Total, avec l’appui de l’armée française qui y a envoyé des formateurs, a exigé de l’État ougandais la création d’une « police pétrolière ». Un villageois chassé de ces terres raconte ainsi : « J’ai perdu toutes mes récoltes, plus aucune culture n’est autorisée et la police nous a dit que toute personne qui essayait de réutiliser ses terres serait torturée. »
Les scientifiques, l’ONU et même le pape ont pris position contre ces projets. Mais peu importe. C’est Total qui décide, et les dirigeants français servent ses intérêts. À l’heure où l’impérialisme français est remis en cause dans son ancien pré carré, il veut d’autant plus avancer dans un pays sous domination américaine. C’est pourquoi, pour Macron, tout est bon pour « accroître la présence économique française en Ouganda ».
Mettre la main sur les gisements, pour en priver leurs concurrents
Partout en Afrique, les entreprises pétrolières recherchent de nouveaux gisements. Alors que les trusts américains, forts de leurs immenses réserves de pétrole et de gaz de schiste en Amérique du Nord, avaient plutôt délaissé le terrain, ils sont de retour. Comme leurs concurrents avancent, les compagnies américaines ont repris leurs prospections, pour « affaiblir l’adversaire et saper son hégémonie », pour reprendre la formule de Lénine en 1916. C’est ce qu’a entrepris ExxonMobil depuis 2018 pour ne pas laisser le terrain au français Total et aux entreprises d’État chinoises.
Ces trusts et leurs États financent des armées de géologues, qui recherchent de nouveaux gisements. En France, le Bureau de recherche géologique et minière joue ainsi un rôle actif dans la « diplomatie des minerais ». Lors d’une visite de Macron en République démocratique du Congo, il a signé un accord avec le service géologique de l’État congolais afin de « renforcer la connaissance du sous-sol congolais ». Traduit en clair, il s’agit de préparer les futurs profits des capitalistes français.
Total, ExxonMobil, Glencore, Rio Tinto… emploient les meilleurs scientifiques et les meilleurs ingénieurs pour découvrir les richesses minérales et pétrolières. Mais ces compétences servent uniquement leurs profits. C’est un gâchis sans nom, car ces scientifiques et les moyens colossaux qu’ils utilisent pourraient assurer le développement réel du continent, à savoir, satisfaire les immenses besoins de la population.
Le prétendu développement de l’Afrique
Du fait de la course aux ressources naturelles, qui requiert des installations industrielles et des moyens de transport, des pans de l’économie africaine se sont développés. C’est avant tout pour alimenter le marché mondial, et très peu l’Afrique, mais la croissance liée aux exportations conduit des journaux économiques à présenter le continent comme une zone en plein développement. Le nombre de millionnaires africains a été multiplié par trois en vingt ans. Il y a même un nouveau mot inventé pour eux : « africapitaliste », comprenez l’entrepreneur africain qui permettrait à son pays d’échapper à la corruption des politiciens et de sortir du sous-développement.
Derrière la propagande de « l’africapitalisme »
Pour en juger, voyons leur modèle, l’homme le plus riche d’Afrique, le nigérian Aliko Dangote. Nanti de quinze milliards de dollars, il est surnommé le Bill Gates africain, dont il est l’ami personnel. Dangote a été initié au commerce par son grand-père. Cet aïeul, issu d’une vieille famille de commerçants, était devenu l’homme le plus riche de l’Afrique coloniale dans les années 1950, en fournissant en produits alimentaires la Compagnie britannique d’Afrique de l’Ouest. Le petit-fils, Dangote, a commencé dans les années 1970, en reprenant l’import-export d’aliments, puis de ciment.
Mais deux événements ont fait exploser sa fortune. D’abord, la privatisation des cimenteries d’État, dans les années 1980. Dangote a profité de ses liens avec la dictature nigériane pour mettre la main dessus à bon marché. Puis, ses affaires explosèrent avec le boom du pétrole, dont le Nigeria devint le premier producteur d’Afrique. Dans la capitale économique, Lagos, les gratte-ciel et grandes constructions poussèrent comme des champignons, les prix des terrains dépassant certaines années ceux de New York ou Tokyo.
C’est ce qui fit la fortune du cimentier Dangote, qui livre aujourd’hui les chantiers de toute l’Afrique. Celui qui se présente comme un self-made-man est le pur produit de l’exploitation coloniale et capitaliste. Avec l’Afrique du Sud, le Nigeria est aujourd’hui la première puissance économique d’Afrique subsaharienne et compte près de 10 000 millionnaires, et quatre milliardaires. Mais quelle est la vie des classes populaires ? Le pétrole imbibe tout. Les pêcheurs et les paysans du delta du Niger, la région pétrolière, sont empoisonnés car les eaux et les sols sont englués de boue noire et huileuse. L’espérance de vie dans cette zone est de 40 ans, 14 de moins que dans le reste du pays. Les villages sont désertés, et les habitants affluent à Lagos, où 20 millions d’habitants s’entassent.
Mais quel travail trouver ? Il existait auparavant une petite production industrielle, dans le textile, la quincaillerie, les matériaux de construction, surtout des entreprises d’État. En vingt ans, elle a été détruite à 90 %. Le Nigeria, soi-disant champion économique avec des taux de croissance de 7 % par an, s’est désindustrialisé. La production électrique totale du Nigeria est identique à celle de la Hongrie, qui compte vingt fois moins d’habitants.
Pour gagner quelques sous, des millions de gens font du trafic de pétrole. Ils embarquent des bidons sur une mobylette, et font des dizaines voire des centaines de kilomètres pour les remplir en douce sur les puits, en payant un bakchich. Puis ils jouent au chat et à la souris avec la police, pour livrer des raffineries clandestines qui chauffent le pétrole sur de petits feux et rendent l’air irrespirable. Par contre, pour trouver de l’essence en station-service, il faut faire des heures de queue. Car, sans raffinerie en état de marche dans le pays, l’essence est importée d’Europe.
En mai dernier, dans une zone franche près de Lagos, Aliko Dangote a inauguré sa raffinerie ultramoderne, où opèrent une myriade d’entreprises occidentales, le géant américain Honeywell, les français Air Liquide et Schneider Electric. Si elle produit un jour les volumes annoncés, elle permettra à Dangote et aux courtiers internationaux de s’enrichir. Mais elle sera surtout un îlot de modernité dans un océan de misère.
La fragilité congénitale de l’économie africaine
Voilà ce que signifie le « développement économique » en Afrique. Non seulement les ressources naturelles sont siphonnées, mais toute l’économie est modelée pour ce pillage. Tous les secteurs, agricoles ou industriels, sont laminés par la concurrence des marchandises moins chères, venues d’ailleurs. Au Sénégal, Lactalis exporte massivement depuis la France du lait en poudre, qui bénéficie des subventions de l’Union européenne, tandis que les éleveurs locaux ne peuvent vendre leur lait. Des pays entiers se retrouvent dépendants du cours en Bourse d’un ou deux minerais, ou du pétrole. Or ces prix fluctuent de façon délirante, au gré de la spéculation financière.
Entre 2000 et 2008, le prix du cuivre a été multiplié par cinq : cela créa le mythe du « miracle africain ». Mais la crise de 2008, en six mois, l’a divisé par trois. Puis multiplié par quatre en trois ans, puis redivisé par trois en cinq ans, puis triplé à nouveau depuis le Covid. Or des pays entiers, comme la République démocratique du Congo, ont leur budget quasi indexé sur le prix du cuivre. Une chute des cours et l’État est en faillite, et des millions de travailleurs passent de la survie à la famine.
Dans le Manifeste du Parti communiste, Marx avait décrit comment la bourgeoisie forçait « sous peine de mort, toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production ». Aujourd’hui, en Afrique, ce processus se poursuit, mettant en œuvre les moyens les plus modernes de transport, de communication, d’exploration, qui atteignent les zones les plus reculées. Ils pourraient transformer la vie de l’humanité de façon prodigieuse. Mais, mis en œuvre par le capitalisme financiarisé, le résultat est monstrueux.
La bourgeoisie africaine, une classe dépendante et compradore
Les nouveaux capitalistes africains sont le type même de ce qui, à l’époque coloniale, était appelé des « compradores ». Ils ne sont pas des concurrents des capitalistes étrangers mais, au contraire, des intermédiaires qui s’enrichissent du pillage de leur propre pays.
Première fortune congolaise, Moïse Katumbi s’est ainsi enrichi dans le transport du cuivre du Katanga comme sous-traitant des compagnies occidentales. Là où les bourgeois occidentaux sont maîtres de leurs affaires et sont servis par leur État, les bourgeois congolais, eux, n’ont aucune indépendance, et ne peuvent survivre qu’avec la protection de l’État ou des seigneurs de guerre qui tiennent lieu d’État local. Beaucoup font eux-mêmes une carrière politique, comme Katumbi, candidat à l’élection présidentielle prévue cette année. Ses liens avec l’ex-président lui ont permis de s’enrichir, avant de devenir lui-même gouverneur du Katanga, et d’y acheter un club de foot pour assurer sa popularité.
Les bourgeois africains qui ne s’enrichissent pas directement des rentes minière et pétrolière sont dans la finance, les télécommunications, l’agroalimentaire, mais très peu dans les secteurs à haut niveau de capital. La bourgeoisie africaine, comme toutes les bourgeoisies tard venues, restée en position subordonnée à l’impérialisme, est une classe parasite et faible qui vit dans l’ombre du pouvoir. Contrairement à la fable qui raconte que ces hommes d’affaires pourraient sortir leur pays du sous-développement, ils sont incapables de développer les infrastructures, les routes, les réseaux d’eau et d’électricité qui seraient vitaux pour des millions d’Africains, mais qui ne sont pas immédiatement profitables.
Au Kenya aujourd’hui, des enfants apprennent ainsi à écrire des lignes de code informatique à l’école, avant de retourner vivre dans leur bidonville, sans eau ni électricité. C’est cela le développement de l’Afrique : celui d’un monde où l’on meurt d’une gastro-entérite, mais où les géants des télécommunications occidentaux s’enrichissent avec des smartphones dont la production nécessite les minerais de sang du Congo et des éléments plastiques qui peuvent provenir du pétrole qui souille le Nigeria.
La déliquescence des États, produit du pillage et des rivalités impérialistes
Le mythe du « développement de l’Afrique » est d’autant plus délirant qu’en réalité, à force de pillage et de guerres, bien des États sont entrés en déliquescence et ne contrôlent plus leur propre territoire. En Afrique centrale, en Somalie, en Éthiopie, au Soudan, des millions d’êtres humains sont depuis trente ans des réfugiés à vie.
Le chaos se propage jusqu’au Sahel
En 2011, les grandes puissances sont intervenues pour renverser Khadafi et prendre le contrôle du pétrole libyen. Cela a entraîné la multiplication des groupes rebelles et djihadistes, et le chaos s’est étendu, d’abord au Mali, grand pays d’Afrique de l’Ouest, puis à tout le Sahel, la vaste région qui borde le désert du Sahara sur des milliers de kilomètres.
En 2013, François Hollande annonça brusquement que la capitale Bamako était menacée par une légion de troupes djihadistes. La France obtint un appel à l’aide officiel des dirigeants maliens. Pour la première fois depuis l’indépendance du pays en 1960, les troupes françaises revenaient au Mali. Cette intervention reposait sur un mensonge du même type que les « armes de destruction massive » inventées par les États-Unis pour envahir l’Irak. Les djihadistes n’étaient que quelques milliers, équipés de simples pick-up et de kalachnikovs. L’eussent-ils projeté, ils n’avaient pas les moyens de prendre une ville de trois millions d’habitants. Mais les menaces ont été montées en épingle pour justifier l’envoi des troupes françaises. Sous toutes les latitudes, à toutes les époques, les États impérialistes mentent toujours.
Nous étions alors les rares, ici en France, à dénoncer cette intervention. Nous écrivions qu’elle ne visait qu’à perpétuer le pillage, à protéger les intérêts d’Areva dans le Niger voisin, et ne pourrait qu’aggraver le chaos, et en aucun cas, améliorer le sort de la population. Pour la France, le véritable but était de réaffirmer son rôle de grande puissance, notamment auprès du parrain américain. C’était aussi une affaire pour les marchands de canons. Le PDG de Dassault déclara : « L’opération au Mali a une influence positive sur l’image du Rafale. »
Cette « opération » fut une sale guerre. La plus importante menée par la France depuis des décennies : 3 000 puis 5 000 militaires stationnés pendant huit ans, encadrant 15 000 soldats, en particulier de l’armée tchadienne, à la brutalité notoire. Avec des villages bombardés, la destruction des quelques centrales électriques, de tout ce qui est nécessaire à la vie, 20 % de la population malienne a été transformée en réfugiés. Les groupes armés, eux, ont prospéré plus que jamais, et sévissent désormais dans toute la région.
Des États déliquescents, tenus à bout de bras par l’impérialisme
Face aux bandes armées, l’État malien est complètement impuissant, comme bien d’autres, du Burkina Faso au Congo. Bien des commentateurs pointent la corruption des dirigeants, parlent même de « malédiction africaine ». Quelle hypocrisie ! En réalité, c’est le produit de la misère et du chaos provoqués par la domination impérialiste.
Engels avait défini l’État par cette formule : une bande d’hommes armés au service de la classe dirigeante. Ici en Europe, sauf dans des périodes de crise politique aiguë, ces bandes armées restent dans l’ombre, car les États prennent aussi en charge, même si c’est de plus en plus mal, des fonctions sociales utiles, école, hôpitaux, généralement plus visibles que les militaires. La stabilité des États n’est pas une question de « culture démocratique » comme on entend souvent, mais repose sur un développement économique suffisant pour qu’ils semblent au-dessus des classes, garants de l’intérêt général. Les États africains, eux, n’ont jamais réuni ces conditions.
Au Mali, après l’indépendance, l’État n’avait presque pas de personnel formé ni de moyens financiers. Il se résumait pour l’essentiel à l’armée, chargée d’exécuter les ordres d’un petit nombre de juges et de préfets, inaccessibles à la population. Comme dans bien des pays pauvres, il ne fait pas bon croiser le chemin d’un représentant de l’ordre, d’un juge ou d’un commissaire. Il faut souvent payer un bakchich pour obtenir un simple papier administratif ou un travail. Pour une broutille, lorsqu’on est pauvre, on risque l’arrestation, voire la mort.
Dans un pays pauvre, presque sans industrie, le pouvoir d’État est un moyen d’enrichissement. L’armée malienne avait sept généraux au moment de l’indépendance ; elle en compte aujourd’hui 150, avec chacun son budget personnel, sa suite, sa voiture de fonction. Le budget de la présidence équivaut à celui des dix principaux hôpitaux du pays cumulés. Symbole de ce pourrissement, l’unique ligne de chemin de fer de Bamako à Dakar, construite sous la colonisation, est à l’arrêt depuis cinq ans faute d’entretien. Si l’État bénéficiait d’un certain soutien populaire à l’indépendance, il l’a vite perdu. Il ne fait que s’engraisser sur le dos de la population qui meurt à petit feu. C’est là le terrain qui fait pousser les groupes armés.
Le djihadisme : des bandes armées qui prospèrent sur la misère et l’absence d’État
Au Sahel, la grande majorité de ces groupes se réclament du djihadisme, du terrorisme islamique. Il y en a eu une multitude, Ansar Dine, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram… Chacun paraît toujours dépasser en horreur le précédent, massacrant des villageois, terrorisant les enseignants sous prétexte qu’ils ne devraient enseigner que les matières autorisées par le Coran, interdisant aux filles d’aller à l’école, en les kidnappant, parfois en les tuant.
Au Mali, les groupes djihadistes ont prospéré depuis la région désertique du Nord, majoritairement habitée par des Touareg, un peuple d’éleveurs repoussé toujours plus vers le désert. Les jeunes sont sans ressources, ils ne peuvent qu’émigrer ou rejoindre les bandes armées. La plupart des « camps de djihadistes » sont en fait des cases habitées par des miséreux, qui imposent leurs impôts sur des villages alentour. Ils vivent de rapines et de trafics de toutes sortes, y compris de la drogue. On est loin des fantasmes des journalistes sur les vastes légions d’Al-Qaïda ou de Boko Haram. Derrière ces allégeances médiatiques, il y aurait une multitude de petites communautés, isolées les unes des autres, et poussées plus par la survie et le détroussage des populations voisines que par la conviction religieuse.
Si les États, soutenus et armés par les grandes puissances, sont incapables d’en venir à bout, cela en dit plus long sur leur propre décrépitude que sur la force militaire de ces groupes. Cela en dit long aussi sur l’incapacité du système capitaliste à apporter ne serait-ce que l’eau courante et à satisfaire les besoins élémentaires des populations.
Pour les habitants de ces régions, les armées officielles ne valent pas mieux que les djihadistes. Lorsque l’armée malienne vient traquer les rebelles, ses soldats n’ont aucun lien avec la population, parfois ils ne parlent pas sa langue, et la considèrent tout entière comme ennemie, exactement comme une armée d’occupation. S’il y a eu une attaque armée dans le secteur, les soldats mettent des barrages sur les routes. Les habitants qui doivent aller au marché vendre leurs produits se font confisquer leur moto. Pour l’armée, il est beaucoup moins dangereux de s’en prendre à des villageois que d’attaquer des groupes armés. Comme toujours dans les guerres en Afrique, des commentateurs expliquent les violences par la haine entre ethnies. Quel mensonge ! Ceux qui alimentent l’ethnisme, ce sont les officiers maliens, burkinabés ou nigériens, et surtout les officiers occidentaux qui les forment. Ils théorisent que les groupes armés sont soutenus par telle ethnie dans son ensemble, comme les Touareg ou les Peuls. En représailles, l’armée malienne, celle reconnue par les grandes puissances, a massacré des villages peuls. D’après des organisations humanitaires, elle aurait tué en 2020 plus de civils que tous les groupes djihadistes.
La guerre et ses pillages sont devenus un état permanent de la société dans toute une partie de l’Afrique. Et bien des États, incapables de résoudre le moindre problème de la population, ne survivent que par la force militaire. Mais les armées officielles, pourries et corrompues, ne savent se battre que contre des villageois désarmés. Les dirigeants ont donc besoin d’autres mercenaires plus compétents. Dans ce qui fut son pré carré, l’armée française a longtemps eu le monopole pour jouer ce rôle. Mais le chaos au Sahel n’a fait que grandir, et l’intervention française y a apporté sa contribution.
Le règne des mercenaires : Wagner et le mythe de l’influence russe
En 2020, le gouvernement malien a été renversé par l’armée, mais cela n’a rien réglé et, l’année suivante, la population est sortie dans la rue, contre l’incurie de l’État, la violence des groupes armés et la présence française. Le régime du colonel Goïta s’est appuyé sur ce mouvement. L’armée française, enlisée dans tout le Sahel, décida à ce moment de quitter le Mali. Et Goïta apparut alors comme l’homme qui résiste à la France et s’est ainsi taillé une popularité. Mais elle est usurpée. Il est le chef d’une armée dont les soldats répriment toute contestation, alors que la population est à bout de nerfs à cause de la vie chère et de la corruption qui gangrène tout.
Pour remplacer les troupes françaises au Mali, Goïta a fait appel à la milice russe Wagner. Les médias français en ont profité pour alimenter le mythe que la Russie, alliée à la Chine, allait chasser les Occidentaux d’Afrique. En Afrique, quelques entreprises russes opèrent bien, comme Rusal pour la bauxite de Guinée. Mais la présence en Afrique de la Russie reste limitée, ses échanges commerciaux sont comparables à ceux de la Turquie. Derrière les annonces des avancées de Gazprom et d’autres conglomérats russes, montées en épingle par les médias français, il y a peu de réalisations concrètes.
Il y a certes Wagner, qui déploierait actuellement 1 500 mercenaires au Mali. Mais cette société militaire privée est comme ses concurrentes, qu’elles soient sud-africaines, américaines ou françaises. Elles vendent leurs services au plus offrant, dans des régions de guerre et d’instabilité profonde. Dans les zones où Wagner opère, des affairistes russes ont mis la main sur certaines mines, mais c’est dans des quantités restreintes. En Centrafrique, l’eldorado africain promis aux 1 000 mercenaires de Wagner ne paie guère, et ils se rabattent comme les autres miliciens sur le racket, le trafic de peaux ou d’ivoire.
Fin 2022, les États-Unis ont proposé au régime centrafricain de former ses troupes en échange de l’expulsion de Wagner. Cela ira-t-il jusqu’au bout ? Après un intermède russe, la Centrafrique basculerait alors du pré carré français à la zone d’influence américaine. Mais pour les populations, ces revirements sont une impasse. Remplacer les barbouzes tricolores par des soudards russes, formés en Tchétchénie à terroriser la population, ne fait qu’alimenter le chaos.
La présence de Wagner ne remet sûrement pas en cause la domination impérialiste. Les mines d’or du Mali, la principale ressource du pays, sont toujours exploitées par des groupes occidentaux, comme l’anglo-canadien Randgold, et l’une d’elles est sous-traitée à une filiale de Bouygues. Que la colère populaire soit canalisée par un colonel malien, que les mines soient gardées par des mercenaires russes, si ça permet que l’exploitation continue, c’est finalement une bonne affaire pour les capitalistes.
La Chine domine-t-elle réellement l’Afrique ?
Un nouveau concurrent est apparu ces dernières années : la Chine. Elle est même présentée comme la nouvelle puissance dominante en Afrique, une puissance déloyale, car ne respectant pas les valeurs démocratiques des honorables investisseurs occidentaux ! En France, ceux qui ont toujours refusé l’expression Françafrique n’hésitent pas à parler de « Chinafrique ». L’ancien vice-président américain Mike Pence a même accusé la Chine de piéger les pays africains par la dette. Quand le vautour en chef se fait passer pour la blanche colombe... Quelle est la réalité derrière cette propagande intéressée ?
La Chine est devenue en vingt ans une partenaire commerciale de premier plan du continent. Des chemins de fer du Soudan aux routes au Congo, en passant par la grande mosquée d’Alger, la présence des entreprises chinoises est spectaculaire. Et en même temps, les capitaux chinois représentent moins de la moitié de ceux de la France ou de l’Angleterre. La Chine reste une puissance secondaire. Les capitaux chinois visent surtout les minerais et le pétrole, dont la Chine a un besoin vital pour ses usines. Ce sont essentiellement des entreprises d’État qui font ces investissements, et surtout dans les secteurs délaissés par les groupes occidentaux car peu rentables ou trop risqués.
Par exemple, le Congo (Kinshasa) a signé en 2008 avec la Chine un contrat de 9 milliards de dollars. Des entreprises chinoises obtenaient les droits d’exploitation de mines de cobalt et de cuivre, en échange de la construction de 32 hôpitaux, 7 000 km de routes, deux universités, et d’autres travaux. Les dirigeants congolais présentaient alors ce plan comme une grande opportunité de développement, car les financiers occidentaux étaient réticents à accorder de nouveaux prêts à cet État en quasi-faillite. L’État chinois, lui, apportait sa garantie, avec une hypothèque sur les terrains miniers en cas de défaut.
Les puissances occidentales dénoncèrent (sans blague !) un « néocolonialisme ». Le FMI et la Banque mondiale firent pression sur l’État congolais pour diminuer les montants du contrat, qui passèrent de 9 à 6 milliards. En échange, le FMI diminuait la dette de l’État congolais, qu’il ne pouvait de toute façon pas rembourser. Les puissances occidentales utilisaient l’arme financière pour limiter l’avancée de leur concurrent chinois.
Quinze ans plus tard, les mines ont ouvert ainsi qu’un barrage hydroélectrique qui alimente une usine de traitement du minerai de cuivre. Mais les habitants voisins n’ont pas accès au courant électrique. Un seul des 32 hôpitaux a été construit, et 600 kilomètres de routes sur 7 000. La Chine se taille ainsi une part du gâteau, mais pour la population africaine les conséquences ne sont guère différentes de la période des « éléphants blancs ».
Si les dirigeants chinois posent aujourd’hui volontiers en porte-parole des pays pauvres, en réalité, les relations de la Chine avec l’Afrique relèvent d’un échange inégal, exactement comme avec les puissances occidentales. Mais il y a une différence de taille. Là où la France, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis réalisent chaque année des dizaines d’interventions militaires en Afrique pour protéger des régimes amis, la Chine n’a presque aucun moyen militaire sur le continent. Elle n’a qu’une seule base avec quelques centaines de soldats à Djibouti, quand la France en a six, que les États-Unis ont un réseau de forces spéciales disséminées sur tout le continent.
La Chine doit compenser cette faiblesse par l’intervention financière de son État. Ainsi, en 2008, lors du krach des prix des matières premières, les entreprises chinoises ont racheté des mines dont l’exploitation n’était plus rentable. Tandis que certaines entreprises occidentales se retiraient, l’État chinois a compensé les pertes financières de ses groupes, pour favoriser leur maintien en Afrique.
Pour les puissances occidentales, la Chine n’est pas vraiment une rivale, elle reste un sous-traitant. Lorsqu’une entreprise chinoise exploite une mine de coltan délaissée par les capitaux occidentaux, et exporte le minerai en Chine pour fabriquer des téléphones portables, à la fin, qui empoche le magot ? À 90 %, c’est l’américain Apple. La Chine s’est intégrée dans le marché mondial dans une position d’intermédiaire ; elle réalise un échange inégal avec l’Afrique, mais elle-même est victime d’un échange inégal avec l’Occident. Sa présence accrue en Afrique renforce ces liens de subordination, dans lesquels les bourgeois occidentaux, et d’abord américains, restent en position de force.
Dans la rivalité permanente entre grandes puissances pour exporter leurs produits industriels et leurs capitaux, pour sécuriser les sources de matières premières, la Chine ne joue pas dans la même catégorie que les pays impérialistes. Partout, ce sont les États-Unis qui sont à l’offensive. En Afrique, la domination américaine a pris depuis une quinzaine d’années une forme militaire plus directe.
La domination américaine s’amplifie : Africom et le militarisme
La désagrégation des États africains et la généralisation des guerres ont poussé les États-Unis à s’impliquer de plus en plus directement, au nom de « la guerre contre le terrorisme ». En 2007, l’armée américaine a créé une division permanente, le Commandement militaire unifié pour l’Afrique, ou Africom. Il compterait 6 000 hommes et dispose d’une base militaire permanente à Djibouti ; mais sa stratégie est plutôt d’agir via les armées locales, par la formation, le contrôle, le renseignement. Il a ainsi établi un réseau de coordination et de commandement à l’échelle du continent, avec des bureaux dans 38 États africains. Lors de la guerre de Libye, en 2011, c’est Africom qui a organisé et soutenu l’action de toutes les armées occidentales, fournissant les renseignements et une grande partie de la logistique. En 2013, quand la France intervenait au Mali, les États-Unis ont établi un camp au Niger voisin, ancienne colonie française, où ils ont maintenant 800 soldats. Mais on ignore l’écrasante majorité des interventions américaines, qui ont lieu en toute discrétion.
En 2014, il y en aurait eu 68 opérations militaires directes. De plus en plus d’officiers africains sont formés par les États-Unis. Chaque année en Afrique de l’Ouest, un exercice militaire appelé Flintlock mobilise des centaines de soldats de l’OTAN et des armées africaines. Des officiers entraînés dans ce cadre, comme le colonel Goïta, ont été impliqués dans les coups d’État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.
Les États-Unis, et derrière eux les puissances de seconde zone comme la France, condamnent en parole ces coups d’État mais en réalité, ils s’en accommodent parfaitement. Le général américain d’Africom a déclaré à propos du colonel putschiste en Guinée : « Nous partageons des valeurs fondamentales », précisant sans rire qu’il s’agissait des « normes démocratiques ». Derrière le baratin sur la transition démocratique, les géants miniers, l’anglo-australien Rio Tinto, le russe Rusal, l’américain Alcoa et un groupe chinois, tous à la fois rivaux et complices, continueront à piller la bauxite de Guinée.
Cependant, même si le bâton des États-Unis est de plus en plus gros, pour reprendre le proverbe cher à Theodore Roosevelt, leur hégémonie passe avant tout par leur puissance économique. Leur poids déterminant à la Banque mondiale et au FMI, qui possèdent 31 % de la dette des États africains, compte autant que le militarisme. La Chine ne détient aujourd’hui que 8 % de la dette publique africaine alors que des financiers privés en possèdent 60 %. Parmi ces vautours de la finance, les banquiers américains Citigroup, JP Morgan, Bank of America ou le fond Blackrock sont en première place. Y chassent aussi la banque britannique Barclays, l’assureur allemand Allianz, le Crédit agricole, BNP-Paribas et la Société générale. Enfin, la domination américaine, c’est aussi le dollar, la monnaie dans laquelle se règlent la plupart des échanges commerciaux internationaux.
L’Afrique ne représentant que 3 % du commerce mondial, l’intérêt des États-Unis pour ce continent a longtemps été marginal. Mais pour contrer l’avancée de leurs concurrents, les États-Unis sont à l’offensive. En 2014, puis en décembre 2022, ils ont organisé des sommets États-Unis - Afrique. Lors du dernier, Joe Biden a annoncé 55 milliards de dollars d’investissements pour les trois ans à venir. Le continent est toujours plus convoité et pillé.
Le prolétariat, force sociale de l’avenir
La transformation sociale accélérée par les guerres
Mais au cœur de ce chaos, les richesses que pompent les capitalistes sont produites par une classe qui n’a fait que se renforcer : le prolétariat.
Cette transformation s’accélère depuis des décennies. Les paysans sont chassés des campagnes par la chute des prix agricoles, et aujourd’hui près de la moitié de la population africaine vit en ville. Au Mali, un pays enclavé et l’un des moins industrialisés d’Afrique, la capitale, Bamako, comptait à peine 100 000 habitants au moment de l’indépendance ; cinquante ans après, en 2009, c’était 1,8 million. Depuis, la guerre au Sahel a encore accéléré le processus et Bamako compte aujourd’hui 3,5 millions d’habitants. Et un plus grand nombre encore de Maliens sont partis dans les grandes villes des pays voisins, à Abidjan en Côte d’Ivoire, à Dakar au Sénégal ; une minorité ont émigré vers l’Europe, notamment à Paris.
C’est un bouleversement immense, du même type que celui décrit par Marx il y a 150 ans pour l’Europe. Plus que jamais, le capitalisme mondialisé brise par le feu et le sang l’isolement des villages et des nations, et forge une armée de millions de prolétaires. Reliés par des milliers de liens, ils forment une vaste chaîne, depuis les relations de voisinage dans les courées des grandes villes, jusqu’aux appels téléphoniques à des milliers de kilomètres.
Une seule classe ouvrière
Mais pour les observateurs internationaux, ce prolétariat n’existe pas. Pour eux, l’Afrique est remplie de réfugiés, de migrants, de miséreux. La réalité, c’est que tous ont une chose en commun : ils doivent travailler pour vivre. Et tous les jours, il leur faut se battre pour nourrir leur famille, pour se faire respecter des patrons. Comme les casseuses de pierres du roman Photo de groupe au bord du fleuve, qui arrêtent le travail pour exiger un meilleur prix du gravier qu’elles fournissent aux intermédiaires du chantier d’un aéroport international.
À Bamako comme à Abidjan, Dakar ou Lagos au Nigeria, la grande majorité des travailleurs vivent de petits boulots. Ceux qui ont des économies achètent une moto pour faire moto-taxi, ou un étal pour vendre des cigarettes, du thé ou d’autres denrées. Les autres se font embaucher, sur les chantiers, comme porteurs d’eau, ou d’autres boulots de manutentionnaires, au port, dans les commerces.
C’est ce que les économistes appellent des « travailleurs informels » car ils ne rapportent pas du profit à un patron bien identifié. Mais cette vision patronale est bien myope. Un porteur d’eau, une femme qui fait bouillir la marmite pour la famille, un vendeur de rue, tous travaillent tous les jours, et sont indispensables. Certains partent se faire embaucher dans les mines d’or, la principale richesse du Mali. Ah là, pas de doute, ils rapportent très formellement aux grands groupes occidentaux ! Sauf que ce sont les mêmes travailleurs, car beaucoup d’ouvriers des mines sont journaliers, passent quelques semaines ou quelques mois sur place, puis retournent en ville. L’exploitation n’a pas besoin d’un contrat de travail, elle est collective.
Et les travailleurs qui ont un contrat de travail, surtout dans les entreprises publiques ou les grandes sociétés, sont tout autant exploités. Par exemple au Mali, la plus grande société de sécurité du monde, la britannique G4S, emploie un millier de vigiles. Ils assurent le gardiennage des ambassades, des institutions internationales, ou des résidences des riches. Certains gardiens ont surnommé G4S la Sangsue car le salaire est d’environ 100 euros par mois pour 12 heures par jour. Les agents de G4S ont fait plusieurs grèves pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Le patron a répliqué en licenciant 500 d’entre eux en 2021, licenciements validés par les juges maliens : entre vampires, on se serre les coudes !
Les travailleurs ne sont pas des victimes, ils se battent !
En Afrique comme partout sur la planète, les travailleurs sont à la base de toute la richesse, et ça leur donne du poids pour combattre l’exploitation. Les dockers du port d’Abidjan, le principal d’Afrique de l’Ouest, ont plusieurs fois fait grève pour leurs salaires ces dernières années, arrêtant largement la machine économique.
En République démocratique du Congo, dans les mines industrielles, qui sont bien plus nombreuses que les mines artisanales montrées dans des reportages, dans les fonderies produisant des plaques de cuivre et les raffineries de cobalt, les travailleurs se battent, ne serait-ce que pour faire respecter le paiement des salaires et la fourniture des équipements de sécurité. En 2020, lors du Covid, dans une grande mine du Katanga, 6 000 travailleurs ont été confinés sur leur lieu de travail pendant deux mois, et se sont battus pour avoir une prime supplémentaire.
Lors de ces grèves, patrons étrangers et politiciens locaux sont complices, y compris ceux comme Katumbi, qui gouvernait le Katanga et qui se pose en défenseur des Congolais contre les exploiteurs étrangers. Lors de plusieurs grèves, Katumbi s’est déplacé en personne faire des boniments aux travailleurs, avant d’envoyer la police les dégager. Chacune de ces luttes met ainsi aux prises les exploités aux exploiteurs de toute nature, et dévoile qui sont leurs amis et leurs ennemis.
C’est ce que vivent tous les habitants des quartiers pauvres, lorsque les autorités font des « déguerpissements », c’est-à-dire décident de raser un quartier pour une opération d’embellissement ou quand un promoteur immobilier veut récupérer les terrains. Mais plus d’une fois, la police et les bulldozers ont dû affronter la mobilisation des habitants du quartier.
Du côté des tiers-mondistes de diverses variantes, on nous répète que la frontière est entre les pays du Nord et ceux du Sud, que l’Afrique n’est qu’une victime malheureuse du pillage. Mais c’est une vision misérabiliste, paternaliste et étroite. Car le capitalisme continue de développer en Afrique une classe ouvrière, nombreuse, jeune, et qui n’a que ses chaînes à perdre. Comme le proclamait déjà le Manifeste communiste, « la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs ».
Il faut renverser le capitalisme
Aujourd’hui différents courants dénoncent les aspects les plus révoltants de la domination impérialiste. Après des décennies de Françafrique, un nouveau courant panafricain réclame le départ des troupes françaises et la fin du franc CFA. Oui, 60 ans après la fin des colonies, la monnaie principale d’Afrique de l’Ouest est toujours contrôlée depuis Paris. Et nous aussi, nous disons : à bas la tutelle de la France ! Troupes françaises, hors d’Afrique !
Mais ce programme ne suffit pas aux exploités. Les casques bleus de l’ONU, les armées locales et toutes les autres bandes de mercenaires sont au service du même système d’exploitation que l’armée française. Pour les travailleurs, ce qui compte, ce n’est pas d’être payé en franc CFA, en naïra nigérian, en éco, la future monnaie d’Afrique de l’Ouest, ou en yuan ; ce qui compte, c’est le montant de la paye. Ceux qui prétendent que changer la monnaie va résoudre les problèmes des travailleurs sont des menteurs.
Ce courant souverainiste, qui se réclame de Sankara, de Lumumba ou du ghanéen Nkrumah, est dirigé par des notables et des petits bourgeois. Ils prétendent parler au nom des intérêts des populations mais sont surtout guidés par leurs ambitions de parvenir au pouvoir et de profiter des privilèges qu’il offre. Des mouvements, se revendiquant de l’humanitaire ou de l’écologie, militent contre certains projets des multinationales, comme le pipeline EACOP en Afrique de l’Est. Mais il faut distinguer deux choses. D’un côté, il y a les habitants qui refusent d’être dégagés sans solution des sites d’exploitation, et qui se heurtent à la police et aux milices privées des compagnies. Ils ont mille fois raison. Et de l’autre, il y a un courant politique qui prétend influencer les dirigeants des États et des grands groupes en faveur des droits des citoyens ou de l’écologie. Ils adressent des pétitions pour convaincre les banques et les assureurs de Total qu’ils ne doivent pas soutenir le projet EACOP. Pour ne pas subir la pollution des industriels, ils en sont à intercéder auprès des dieux de la finance !
Ces mouvements réformistes, présents surtout dans la petite bourgeoisie, sont impuissants. Imaginer qu’on peut empêcher les projets dévastateurs des grands groupes sans renverser l’impérialisme de fond en comble, c’est une utopie. Et quand ils l’envisagent au nom du souverainisme, de la défense des modes de vie traditionnels, c’est même réactionnaire. L’Afrique ne peut pas échapper à l’intégration dans le capitalisme. Mais celui-ci n’amène pas seulement la pauvreté et la pollution.
Le village le plus reculé de l’est du Congo n’est peut-être pas accessible par une route carrossable, mais on y utilise des téléphones 4G pour communiquer par vidéo avec l’autre bout du monde, et on y trouve des marchandises venues des pays les plus éloignés. Elles viennent en camions, par des chemins qui paraîtraient inaccessibles même en 4x4, sauf qu’il y a une armée de travailleurs capables de les apporter ! Et c’est cela qui ouvre un autre avenir.
Tous ces liens de production, de communication et d’échange doivent se transformer en unité politique des travailleurs. C’est cela qui manque aujourd’hui, car des luttes déterminées, embrassant des millions d’hommes et de femmes, il y en aura.
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
Fin 2014 au Burkina Faso, les jeunes et les pauvres massivement mobilisés ont imposé le départ de Blaise Compaoré. Mais l’armée est immédiatement entrée en scène et a convoqué des opposants et des associations citoyennes pour jouer la comédie de la transition démocratique, avec l’appui de la France. Et comme le chaos politique n’a fait que s’aggraver, en 2022, l’armée s’est imposée directement au pouvoir. Pour les classes populaires, c’est toujours la survie au quotidien. Dans bien des pays cette histoire s’est répétée.
Au Sénégal, début juin 2023, la colère a explosé contre le président Macky Sall et l’incapacité de son régime à répondre aux aspirations de la jeunesse. Macky Sall a finalement renoncé à briguer un troisième mandat mais si son opposant le remplaçait au pouvoir, rien ne changerait pour les classes pauvres, confrontées au chômage et à la vie chère.
Ces problèmes, seuls les travailleurs eux-mêmes peuvent les résoudre, en défendant collectivement leurs intérêts : des salaires décents et réguliers permettant de faire face à la flambée des prix, la fin du travail journalier et payé à la tâche, l’accès à la santé et à l’éducation pour les enfants, des logements dignes. À chaque révolte, des mouvements d’opposition, des associations démocratiques ou des militaires même répandent des illusions de changement à la tête de l’État. Mais nulle part, les classes populaires n’ont quoi que ce soit à en espérer. Partout, les classes laborieuses ne peuvent compter que sur elles-mêmes.
L’exemple de l’Afrique du Sud doit nous servir de leçon. Dans ce pays le plus industrialisé du continent, où le prolétariat représente depuis longtemps une force, ce sont les luttes des travailleurs qui ont abattu l’odieux régime d’apartheid. Mais si le racisme d’État a disparu, l’oppression sociale et l’exploitation demeurent. Elles se sont même aggravées. Dans les grèves, les travailleurs s’affrontent aux forces de police et au pouvoir de l’ANC, le parti de Mandela, qui sert les capitalistes, qu’ils soient blancs ou noirs.
À chaque fois que les travailleurs sont entrés en lutte derrière des dirigeants nationalistes de la petite bourgeoisie, ils se sont retrouvés dans un piège. Pour que les combats des masses pauvres débouchent sur un changement profond, il faut opposer aux revendications démocratiques bourgeoises un programme de classe. Le prolétariat n’a pas d’intérêt national, pas de propriété privée, pas de privilège à défendre.
L’avenir de plus d’un milliard et demi d’habitants d’Afrique se confond avec sa capacité à se mettre à la tête des masses pauvres dans les luttes futures, et à s’attaquer aux capitalistes, qu’ils soient africains, occidentaux ou chinois, aux États nationaux qui défendent leurs intérêts et au-dessus d’eux à la domination impérialiste.
Une classe ouvrière internationale
Et dans ce combat, le prolétariat d’Afrique a un autre levier : ses liens avec les travailleurs d’Europe, d’Amérique et même de Chine. Lors de la vague de révoltes des années 1950-1960, l’impérialisme avait été contesté dans les pays pauvres, mais pas réellement menacé au cœur, dans ses citadelles. Mais à l’époque, les liens internationaux étaient plus faibles qu’aujourd’hui. En Afrique, le prolétariat ne formait lui-même qu’une petite minorité, tandis que de larges couches de la population vivaient encore en marge des échanges capitalistes.
L’intégration de l’Afrique dans l’ordre impérialiste est aussi passée par l’émigration. Des milliers de jeunes se lancent chaque année dans la traversée vers l’Europe, prêts à tout risquer. Ils se heurtent à la politique criminelle des puissances européennes à leurs frontières. Même pour ceux qui réussissent à arriver en Europe, les difficultés ne sont pas finies, et beaucoup ressentent du désenchantement. Mais en rejoignant ainsi les rangs de la classe ouvrière européenne, ils contribuent à tisser des liens à l’échelle planétaire entre les exploités.
Dans la plupart des pays d’Europe, pas une usine, pas un grand chantier, pas un hôpital ne peut fonctionner sans les travailleurs africains. Un vigile de G4S au Mali a peut-être un frère ou un fils à Paris, qui a presque le même uniforme et surveille une gare, un entrepôt ou une usine pour Securitas, Brinks ou une autre sangsue. Lui aussi fait des journées de 12 heures, pour un salaire certes supérieur, mais qui ne permet pas de payer ses factures sans faire d’heures supplémentaires ou un deuxième boulot. Et tous ces travailleurs communiquent tous les jours par Whatsapp avec leur famille et leurs amis restés au pays.
Ces liens sont une force extraordinaire. Toute lutte résolue des travailleurs d’Afrique provoquera un électrochoc parmi la couche de travailleurs la plus exploitée des pays impérialistes, celle aussi la moins influencée par le réformisme des organisations syndicales et politiques. Dans les années 1960, les Noirs américains, la fraction la moins organisée et la plus exploitée du prolétariat des États-Unis, s’étaient révélés brusquement comme la force motrice des opprimés, au cœur même de la citadelle de l’impérialisme mondial.
Aujourd’hui, l’unification du monde est bien plus profonde. La classe ouvrière africaine est présente d’un bout à l’autre de la chaîne de production capitaliste, des bidonvilles les plus infâmes du Mali jusqu’aux usines et aux laboratoires les plus modernes des États-Unis. Cette situation lui donne un rôle déterminant dans la révolution mondiale.
La nécessité d’un parti ouvrier communiste en Afrique… et partout !
Il y a plus de cent ans, la mondialisation capitaliste avait fait naître dans la Russie tsariste le prolétariat le plus jeune, le plus exploité d’Europe. Des militants, en lien avec la IIe Internationale dont les grandes organisations étaient en Europe de l’Ouest, y implantèrent les idées marxistes. Et en 1917, défiant bien des pronostics et des préjugés, ce furent ces travailleurs russes qui reprirent finalement le meilleur des idées révolutionnaires, qui ébranlèrent le monde et régénérèrent le mouvement ouvrier.
Aujourd’hui, le prolétariat d’Afrique a bien des traits similaires. Il est jeune, combatif, concentré dans d’immenses villes. Tout le continent est une cocotte-minute, les coups de colère y sont permanents, les illusions réformistes n’y ont pas la base matérielle qui les nourrit encore dans les pays riches. Même partie d’un seul pays, une révolte profonde serait contagieuse. On ignore bien sûr dans quel pays, d’Afrique, d’Europe, ou d’ailleurs, démarreront les prochaines luttes des travailleurs, mais elles exploseront nécessairement. Et par sa situation, la classe ouvrière africaine pourrait être une force motrice pour dépasser les préjugés nationaux, secouer les illusions et la routine, et entraîner les autres travailleurs qu’elle côtoie sur tous les continents.
Mais cette perspective ne se concrétisera que si elle devient un objectif conscient. Que ce soit en Afrique ou dans les citadelles de l’impérialisme, il faut que des jeunes et des moins jeunes s’engagent, avec l’énergie de ceux qui ont osé traverser les mers ou qui doivent se battre chaque jour pour leur survie, pour défendre les idées communistes révolutionnaires et construire le parti indispensable pour que la classe ouvrière les fasse siennes. La perspective de la révolution ouvrière n’est pas un rêve, elle est préparée par toute l’évolution de l’économie mondialisée actuelle, elle est une nécessité dans la marche de la société humaine.
S’engager dans ce combat, c’est finalement la seule manière solide de préparer une page nouvelle, pour l’Afrique comme pour l’humanité entière.
[1] Deuxième congrès de l’Internationale communiste, juillet 1920.
[2] Gaston Donnat, Afin que nul n’oublie, itinéraire d’un anti-colonialiste, 1986.
[3] Comité central du PCF, brochure Au service de la renaissance française, 1944.
[4] Circulaire du PCF sur l’orientation de la direction des organisations politiques en Afrique, 20 juillet 1948.
[5] Christophe Boltanski, Minerais de sang, les esclaves du monde moderne, 2012.